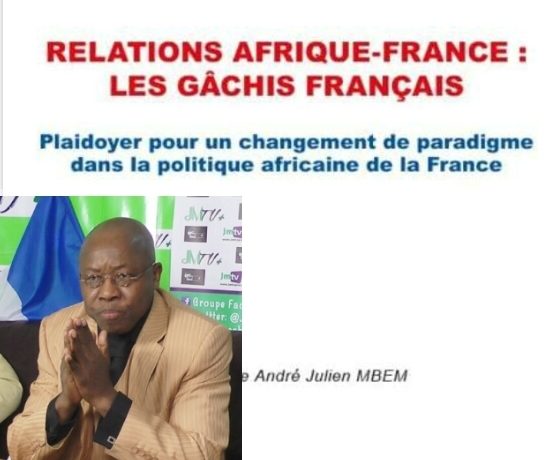(texte)
Introduction
La capitulation à la fin d’une guerre est un acte formel juridique qui marque la reddition de la partie belligérante qui a perdu et la cessation des hostilités. C’est processus régi par un ensemble de règles du droit international, c’est-à-dire, reconnu par les états.
L’objectif de ces règles est de garantir une transition pacifique et ordonnée vers la fin des combats et le rétablissement de la paix.
Les principes juridiques de la capitulation
La reddition d’une armée ou d’une nation est scrupuleusement encadrée par des conventions internationales et des traités.
Question : Sur le plan militaire, comment sait-on qui a perdu et qui a gagné ?
Réponse : Au début de chaque guerre, chaque belligérant annonce qui prend le nom de « Buts de Guerre ». A un moment donné du conflit, lorsqu’une des parties n’a plus la forces ou les ressources pour continuer la guerre, sans avoir obtenu ce qu’il avait annoncé au départ comme « but de guerre », il est considéré comme le perdant et c’est lui qui doit capituler en acceptant toute la liste que l’autre belligérant avait affiché comme « but de guerre ».
Dans le cas du conflit ukrainien, dès le début, on a compris très vite que l’Ukraine était très mal conseillée par les Occidentaux qui, dans leur soutient, n’ont jamais communiqué leur but de guerre. Ceci nous permet de tirer deux observations :
1) Dire qu’on va aider l’Ukraine pour empêcher la Russie de gagner, était une manière trop générique apportant les preuves que depuis le début, les Etats-Unis n’ont jamais cru à la victoire de l’Ukraine sur la Russie. Sinon, ils auraient clairement établi un but de guerre.
2) L’Ukraine a précipitamment annoncé que son « but de guerre » était de récupérer tous les territoires perdus depuis 2014, c’est-à-dire la Crimée comprise. Cela était bien entendu une faute de communication, car lorsqu’on va en guerre, on reste vague ou tout au moins, très en déça de l’objectif qu’on aimerait atteindre. Cela vous donne la possibilité de crier victoire à minima.
C’est un peu ce qu’a fait la Russie qui n’a jamais dit ses vrais buts de guerre en dehors de la rhétorique de désarmer l’Ukraine et l’empêcher d’entrer dans l’Otan. A ce stade, personne ne sait toujours, si Moscou veut occuper toute l’Ukraine ou pas. Ce flou assumé donne à la Russie une plus grande marge de manœuvre pour adapter ses prétentions de résolution du conflit à la réalité du rapport de force militaire sur le terrain à la date du début de la négociation, pour la capitulation de la partie adverse. En d’autres mots, n’ayant jamais dit s’il veut contrôler le gouvernement à Kiev à la fin de la guerre, avant la rencontre entre les russes et les américains en Arabie Saoudite, personne ne peut répondre avec lucidité à la question de savoir ce que veulent réellement les russes en Ukraine.
Les autorités russes ont toujours insisté sur le fait qu’ils ne sont pas en Ukraine pour un problème de territoire, mais de la garantie pour leur propre sécurité.
Là aussi, les occidentaux ont prodigué à Kiev des mauvais conseils qui risquent de se révéler fatals pour la rédaction de l’acte de capitulation de l’Ukraine.
- En donnant à l’Ukraine des missiles à longue portée qui lui ont permis de toucher des cibles en territoire russe, alors que tout le monde savait que cela n’aurait rien joué dans le sort de la guerre, les Occidentaux ont condamné l’Ukraine à se présenter à la négociation en condition de faiblesse, ou tout au moins, ils ont fourni à la Russie, une raison à faire valoir à l’acte de la capitulation, pour prétendre de l’Ukraine, plus d’espace tampon, pour l’empêcher de menacer le territoire russe. C’était en effet la raison pour laquelle, à chaque tir de missile à moyenne portée occidental par l’Ukraine sur la Russie, cette dernière faisait la plus grande publicité sur ces actes non plus de guerre, mais de sabotage et de terrorisme, comme les dépôts de carburant en territoire russe, ou le pont de Kertch que les généraux allemands ont été découvert en flagrant délit en train de programmer sa destruction.
- L’occupation par l’armée ukrainienne d’une partie du territoire russe, est plutôt une très mauvaise nouvelle dans l’acte de capitulation de l’Ukraine. C’est même pour cela que la Russie n’est pas pressée à expulser la totalité des forces ukrainiennes dans sa région frontalière de Koursk. Car c’est un argument qui renforce la narration russe qui a précédé le début des hostilités lorsque les Russes accusaient l’Ukraine de représenter une menace pour le territoire russe. Le fait qu’il y a les troupes ukrainiennes en Russie au moment de signer l’acte de capitulation suggère que la Russie va utiliser ce fait pour conclure la négociation avec l’Ukraine sur un ton beaucoup plus sévère, à la limite, punitif.
- Aujourd’hui, il n’y a pas de bateau russe en mer Noire. Ce que les occidentaux présentent comme une victoire ukrainienne est plutôt une manœuvre russe à travers laquelle un piège a été tendu aux Ukrainiens et ils y sont tombés, en envoyant des drones maritimes chargés d’explosifs contre les bateaux russes surtout ceux stationnés en Crimée, fondamental pour l’armée russe. Cela signifie que même s’il n’y a pas eu de confrontation directe entre l’armée russe et ukrainienne à Odessa d’où partaient ces drones, le sort de cette ville portuaire, seul accès de l’Ukraine à la mer est presque scellé, puisque la Russie va inscrire dans l’acte de capitulation le danger que cette ville représente pour les bateaux russes stationnés à Sébastopol, en Crimée juste en face. Etant donné que ces actes n’avaient rien de décisif dans le sort de la guerre, je me suis toujours demandé comment les occidentaux pouvaient prodiguer à l’Ukraine des conseils aussi erronées dans le choix des cibles en Russie. En ignorant complètement le fait qu’un jour, il faudra se retrouver autour d’une table pour négocier, sur la base de comment les deux belligérants se sont comportés durant la guerre. C’est ce qui explique que la Russie fait le maximum pour éviter les victimes civiles ukrainiennes durant ses centaines de bombardements par missiles et drones souvent quotidiens. La Russie démontre ainsi que l’Ukraine qui va capitulée, sera bien traitée par la Russie, de la même manière que cette dernière l’a fait dans le choix et la précision des cibles pour ses bombardement durant trois ans de guerre.
Une fois observé tous ces éléments, on peut maintenant passer au contenu même de l’acte de capitulation de l’Ukraine.
Voici certains principes fondamentaux et les conventions internationales qui régissent ce processus de capitulation :
DEFINITION
La capitulation, aussi appelée : la reddition, est un acte par lequel une force militaire perdante, met fin à ses hostilités et se soumet à l’ennemi plus fort. Cet acte se produit très souvent à la fin d’un conflit armé, et il est régi par plusieurs règles et conventions internationales dont le but est d’éviter le désordre et le chaos à la fin d’un conflit armé, et pouvoir par conséquent, garantir une cessation ordonnée des combats et à protéger les droits des combattants perdants qui déposent les armes pour se rendre et des civils.
Les différentes conventions internationales sur la capitulation :
La Convention de La Haye (1899 et 1907)
La première Conférence de la Paix de 1899 fut convoquée à la Haye par le Tsar de Russie, Nicolas II, afin de “rechercher les moyens les plus efficaces d’assurer à tous les peuples les bienfaits d’une paix réelle et durable et de mettre avant tout un terme au développement progressif des armements actuels” (Note russe du 30 décembre 1898/11 janvier 1899).
Trois sujets sont à l’ordre du jour : la limitation des armements, des effectifs et des budgets militaires ; la mise en place de conventions visant à réduire, en temps de guerre, l’usage des armes les plus meurtrières et les souffrances inutiles ; la reconnaissance, pour les cas qui s’y prêtent, du principe de l’arbitrage « dans le but de prévenir des conflits armés entre nations ».
Vingt-six gouvernements étaient présents à la séance d’ouverture de la Conférence à La Haye, le 18 mai 1899. Trois Conventions et d’autres actes mentionnés dans l’Acte final ont été adoptés le 29 juillet 1899. Des dispositions ont également été prises pour convoquer une deuxième conférence. Celle-ci eut lieu à La Haye, du 15 juin au 18 octobre 1907.
Source : https://ihl-databases.icrc.org/fr/ihl-treaties/hague-finact-1899
Ces deux Conventions de La Haye de 1899 et 1907 convoquées par la Russie, sont parmi les premiers traités internationaux qui énumèrent clairement les règles détaillées sur la conduite des guerres, de son déclenchement jusqu’à la capitulation. Ces conventions établissent des principes généraux dont le but principal est celui d’humaniser les conflits et à protéger les combattants et les non-combattants. Concernant la capitulation, ces deux conventions de la Haye disent que les termes de la reddition doivent être négociés de bonne foi et respectés par les deux parties.
Les Conventions de Genève (1949)
Les Conventions de Genève de 1949, et leurs protocoles additionnels, constituent le cadre juridique le plus complet pour la protection des victimes des conflits armés. Elles contiennent des dispositions spécifiques relatives à la capitulation, notamment en ce qui concerne le traitement des prisonniers de guerre. Les conventions exigent que les prisonniers de guerre soient traités avec humanité, protégés contre les actes de violence, et reçoivent les soins et l’assistance nécessaires.
Les Protocoles additionnels aux Conventions de Genève (1977)
Les Protocoles additionnels de 1977 renforcent les dispositions des Conventions de Genève en élargissant leur champ d’application aux conflits armés non internationaux et en précisant les protections accordées aux personnes ne participant pas directement aux hostilités. En ce qui concerne la capitulation, ces protocoles insistent sur l’importance de protéger les civils et de faciliter le retour à la paix.
Les pratiques militaires et les accords de capitulation
Les négociations de la capitulation
Les capitulations sont généralement précédées par des négociations entre les commandants des forces belligérantes. Ces négociations peuvent se dérouler directement sur le champ de bataille ou par l’intermédiaire de représentants désignés. Les termes de la capitulation peuvent inclure des conditions telles que la cessation des hostilités, le désarmement des forces, la libération des prisonniers de guerre, et les garanties de sécurité pour les civils.
Les documents de capitulation
Les accords de capitulation sont souvent formalisés par des documents écrits signés par les représentants des parties en conflit.
Ces documents précisent les termes et conditions de la reddition, et ils ont force de loi une fois signés. Ils peuvent également inclure des dispositions concernant l’administration des territoires occupés et la protection des biens culturels et historiques.
Le respect des termes de la capitulation
Le respect des termes de la capitulation est essentiel pour maintenir la confiance entre les parties en conflit et pour faciliter la transition vers la paix. Les violations des accords de capitulation peuvent entraîner des représailles, prolonger les hostilités, et compliquer les efforts de reconstruction post-conflit. Les commandants militaires et les forces armées sont tenus de respecter les termes de la capitulation et de veiller à ce que leurs subordonnés fassent de même.
Dans notre cas de l’Ukraine, nous avons appris hier dimanche 16/02/2025 que l’envoyé des Etats-Unis Kellogg a dit clairement que les pays européens n’y seront pas associés. Ce qui a valu une vive protestation de ces pays exclus.
Mais quand on regarde de plus près, on se rend compte du fait que les Européens n’ont jamais considéré la simple éventualité d’une défaite de l’Ukraine qu’ils soutenaient. Ce qui n’est pas le cas des Etats-Unis.
Alors qu’en 2022, le président français Emmanuel Macron divulguait au public, pour faire du buzz, une conversation confidentielle avec le président de la Fédération de Russie, Vladimir Poutine, dans l’optique de faire partie comme arbitre de la négociation pour la fin du conflit, les Etats-Unis ont profité de la transition politique à Washington, pour faire passer la nouvelle administration Trump, comme la grande amie de la Russie. Ce qui lui a garanti son ticket pour faire partie des négociations, non pas comme belligérants, mais comme arbitre au milieu des deux belligérants, la Russie et l’Ukraine, comme si les Etats-Unis n’y avaient jamais pris part.
Quand le président Trump dit : « La Russie veut négocier pour mettre fin à la guerre, l’Ukraine aussi veut négocier pour terminer cette guerre qui n’aurait jamais dû commencer », il s’octroie ainsi à lui-même, la crédibilité de faire partie des négociation.
C’est ce que Emmanuel Macron, le président français n’a pas compris, se mettant à proposer d’envoyer les troupes au sol, pour venir en aide aux troupes ukrainiennes en difficulté, il partageait en même temps le fardeau de la défaite de l’Ukraine. Ce qui le disqualifiait d’office pour être invité à la table de négociation, sinon, pour faire la vaisselle et puis c’est tout.
La France devient ainsi d’office disqualifiée pour faire partie des négociateurs, pour pacifier les deux belligérants.
Voici quelques exemples historiques de capitulations
La capitulation de l’Allemagne en 1945.
L’un des exemples les plus marquants de capitulation est celle de l’Allemagne nazie à la fin de la Seconde Guerre mondiale. Le 8 mai 1945, le haut commandement allemand signe l’acte de reddition inconditionnelle à Berlin, mettant fin à la guerre en Europe. A partir de cet acte, ce sont les gagnants sur l’Allemagne qui vont faire du pays ce qu’ils veulent, jusqu’à diviser la capitale Berlin en deux villes différentes.
La capitulation du Japon en 1945
Quelques mois après la reddition allemande, le Japon signe à son tour l’acte de capitulation le 2 septembre 1945, à bord du cuirassé USS Missouri. Cette capitulation met fin à la guerre dans le Pacifique et marque le début de l’occupation américaine du Japon, ainsi qu’une série de réformes politiques et économiques visant à reconstruire le pays.
La reddition de Napoléon en 1815
Un autre exemple historique est la reddition de Napoléon Bonaparte après sa défaite à la bataille de Waterloo en 1815.
Napoléon abdique et se rend aux forces alliées, marquant la fin de son règne et le début de la Restauration des Bourbons en France.
La capitulation de la France (1871)
La capitulation de la France à la fin de la guerre franco-prussienne est un autre exemple classique de capitulation.
Le 19 juillet 1870, la France déclare la guerre à la Prusse. Le 28 janvier 1871, le gouvernement français signe la capitulation avec la Prusse. Les opérations militaires s’achèvent ce même jour du 28 janvier 1871 avec la défaite de la France et la conséquente, capitulation de Paris. Le conflit se termine le 10 mai 1871 (avec le traité de Francfort), après avoir provoqué la chute du second empire (de Napoléon) et la proclamation de la république. Avec la défaite, la France voit son territoire amputé de l’Alsace et d’une partie de la Lorraine. Ces régions, incorporées à l’empire allemand, ne redeviendront françaises qu’après la victoire de 1918 et la capitulation à son tour de l’Allemagne.
La défaite a toujours une conséquence fâcheuse pour les perdants.
Dans ce cas, dans l’acte de capitulation, la France a signé de perdre deux régions du territoire français, l’Alsace et une partie de la Lorraine ?
La remise des armes et du matériel militaire
La capitulation implique souvent la remise des armes et du matériel militaire du perdant à l’autorité victorieuse. Cela peut inclure la destruction ou la désactivation des armes, ainsi que la démobilisation des troupes. Dans notre cas, cela fait partie des buts de guerre de la Russie : désarmer l’Ukraine ! Voilà pourquoi il est facile de prévoir que cette même Russie ne peut pas accepter non seulement à la table de négociation les européens qui ont financé la guerre et armé les Ukrainiens, mais aussi que ces mêmes pays rentrent ensuite en Ukraine avec des armes, sous prétexte qu’ils vont vérifier le cessez-le-feu.
Surveillance et vérification
Des mécanismes de surveillance et de vérification peuvent être mis en place pour s’assurer que les conditions de la capitulation sont respectées. Cela peut inclure la présence de forces internationales ou de missions de maintien de la paix. Et c’est ici qu’on peut jurer que jamais la Russie ne laissera le moindre pays de l’Otan entrer en Ukraine, soi-disant pour contrôler le cessez-le-feu. Ce serait repartir dans 4 ou 5 ans avec un nouveau conflit entre l’Ukraine encore plus aguerrie et la Fédération de Russie.
Jean-Paul Pougala
Lundi le 17 février 2025